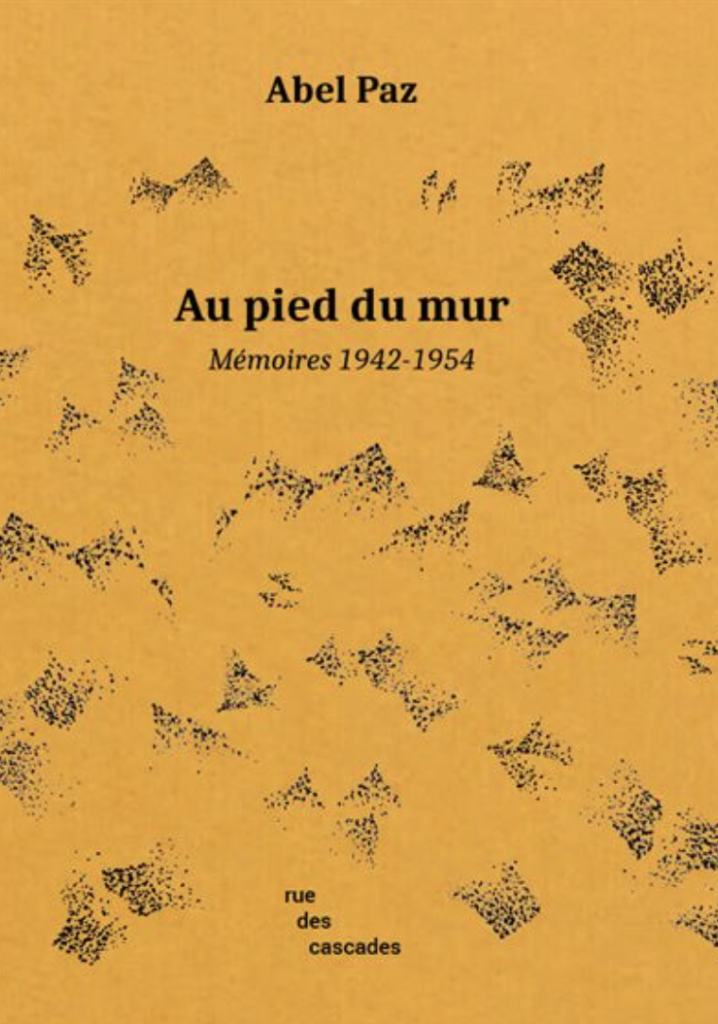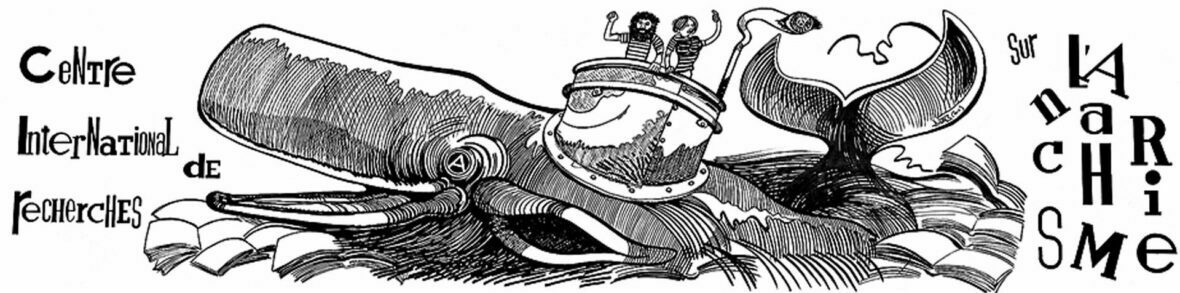Intervention de Freddy Gomez à la rencontre des Amis de Rue des Cascades organisée au « Lieu dit », le 19 octobre 2023, autour du thème « Mémoires d’hier dans les luttes d’aujourd’hui » à l’occasion de la parution d’Au pied du mur : mémoires 1942-1954 d’Abel Paz, dernier livre de la maison d’édition fondée par Marc Tomsin (1950-2021).
Il y a trois ans, à la sortie de Scorpions et figues de Barbarie, première exploration autobiographique d’Abel Paz publiée Rue des Cascades, l’ami Marc Tomsin en avait fait une présentation au CIRA de Marseille. Il y évoqua, entre diverses références bibliographiques, mais en y insistant, le remarquable livre du regretté Alain Pessin, La Rêverie anarchiste. Parce qu’il révélait à ses yeux, quelque chose que les historiens de l’anarchisme peinent à saisir : cette part commune de l’imaginaire libertaire qui rend les anarchistes, aussi divers fussent-ils, reconnaissables entre eux, mais insaisis-sables aux yeux de l’expertise.
Je pense, comme lui, que ce livre est, en effet, l’une des meilleures portes d’entrée dans l’histoire sensible de l’anarchisme.
C’est donc à partir des réflexions d’Alain Pessin que je vais tenter de traiter du sujet qui est censé nous occuper ce soir, à savoir « Mémoires d’hier dans les luttes d’aujourd’hui ».
Il est possible que l’anarchisme vaille davantage par son imaginaire que par ses constructions théoriques. Les marxistes en ont d’ailleurs fait matière à gausserie. C’était ignorer que les rêves durent plus longtemps que les théo-ries, celui de l’émancipation en particulier. C’est précisément cette addiction à la rêverie, à sa quête effrénée, qui rend en principe les anarchistes curieux de toute révolte sociale. Quand Bakounine va à Lyon, puis à Marseille, pour participer aux émeutes communalistes de 1870-1871, Marx se contente, pendant la Commune de Paris, d’y déléguer quelques-uns des siens pour lui fournir des notes qui lui serviront à rédiger La Guerre Civile en France. Pour le premier l’événement révolutionnaire enflamme le rêve émancipateur ; pour le second, il est matière à faire un livre, grand livre au demeurant, devant nourrir son oeuvre théorique. Je n’en tire pas une conclusion, je pointe une différence.
L’autre différence est de style. C’est en retournant le stigmate identitaire d’« anarchistes » (entendons par-là de bordélisateurs) dont les marxistes les avaient affublés que les anti-autoritaires de la Première Internationale le re-prirent à leur compte. Par défi, en somme. « Ah ! bon, “anarchistes”, dites-vous, très bien : anarchistes, ce sera. » Le style, c’est important. Et puis, tracer son empreinte comme exilés terribles du sort commun, ça a de la gueule, non ? Surtout, quand cette empreinte a déjà une longue histoire : celles des
« enragés » et des « sectionnaires » de la Grande Révolution, qui s’étaient eux-aussi faits traiter d’anarchistes par les bourgeois, y compris robespierristes, qui voulaient la canaliser, avant de choisir de l’écraser.
Le retour du refoulé s’accompagne toujours d’un ressourcement mythique. Il opère au prix d’une réappropriation imaginaire des combats gagnés d’avoir été provisoirement perdus. Car on sait aujourd’hui que, sur le terrain des révolutions du XXe siècle, les supposées victoires ont toujours été des défaites assurées. Et pour longtemps.
À maintenir vivant le fil de la mémoire des anciennes révoltes sociales, l’on peut se faire une idée de ce qui s’y joua d’essentiel en matière de réappropriation de notre indéfectible humanité rebelle dans ce présent-passé – et de ce s’y joue encore dans l’ici et maintenant de nos soulèvements. C’est à le retisser, ce fil, qu’il nous faut nous atteler, pour faire lien imaginaire entre l’hier, l’ailleurs et l’aujourd’hui. Car chaque révolte sociale, aussi étroite soit-elle dans ses objectifs et à quelque échec qu’elle puisse mener, est toujours l’esquisse d’une promesse infinie : celle d’un assaut répété contre l’état de choses. Se ressaisir de l’ancienne mémoire des combats perdus, c’est armer notre détermination pour ceux d’aujourd’hui. Contre tous les pouvoirs constitués ou émergents. Et d’abord ceux qui s’entêtent, au sein même de notre camp, à penser les mouvements comme devant être canalisés. La nouveauté de ces temps, c’est que, depuis les Gilets jaunes, personne ne souhaite plus être canalisé, dressé, parqué, manipulé, que l’horizontalité est redevenue une aspiration première et le refus des représentants un choix stratégique. On pourrait y voir, et ce ne serait pas faux, un exemple-type de retour du refoulé de la vieille mémoire, mais à condition d’y voir aussi une réélaboration spontanée d’anciennes formes de lutte. De même que, sous un autre nom – le « désarmement » –, on assiste à un retour, comme méthode, de la très ancienne forme du sabotage, un temps statutairement admis, rappelons-le, par la CGT syndicaliste révolutionnaire des origines, comme faisant pleinement partie, au même titre que la grève géné-rale, de l’arsenal des moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre l’exploitation et la domination. Là encore, la connexion est avérée entre deux tem-poralités distantes d’un gros siècle et, là encore, elle indique que, d’allers en retours, notre présent perpétuel de la soumission peut voler en éclats.
Je suis de ceux qui pensent qu’il faudrait réécrire le refrain de L’Internationale en modifiant substantiellement son accroche. Car ce n’est plus du « passé » qu’il faut faire table rase, mais du « présent ». « C’est l’identification du présent perpétuel comme adversaire fondamental – écrit Jérôme Baschet dans Défaire la tyrannie du présent – qui conduit à proposer une alliance stratégique entre passé et futur. » Une alliance contre la désespérance et l’oubli, en quelque sorte, qui permettrait d’inverser la grammaire des temps historiques en rompant avec le vieil évolutionnisme marxiste – ce progressisme enchanté, mais très peu enchanteur, en réalité.
Depuis la Révolution espagnole de l’été 1936, les subversions les plus porteuses d’espérance de ces dernières décennies sont désormais celles qui, comme le disait le sous-commandant Marcos, défient « le désenchantement du présent en posant un pied dans le passé et l’autre dans le futur ». Contre la « fin de l’histoire » des néo-libéraux et la vague postmoderne qui l’accompagne en mettant en cause la possibilité même de penser une perspective historique cohérente. « Notre lutte – pouvait-on lire dans un document de l’EZLN de 1996 – est pour l’histoire et le mauvais gouvernement propose l’oubli. Nous luttons pour prendre la parole contre l’oubli, contre la mort, pour la mémoire et pour la vie. Nous luttons par peur de mourir la mort de l’oubli ». On ne saurait mieux dire en si peu de mots sur nos enjeux.
Jamais l’oppression n’a pu annuler entièrement la dignité des vaincus de l’histoire. Leur mémoire est toujours là, saisissable, prête à bondir dans notre présent orphelin. Il suffit de la saisir pour qu’elle nous saisisse. La tâche est inachevée, jamais perdue. Le passé est la seule source d’énergie historique pour affronter ce présent désormais algorithmé, artificialisé, défait, li-vré à la marchandisation sans fin des corps et des esprits qui nous réduit à l’état de monades concurrentes se livrant, sous l’oeil goguenard du Capital, une pathétique guerre de toutes et tous contre tous et toutes.
« Nous sommes l’histoire têtue qui se répète pour ne plus se répéter », dit encore la parole zapatiste. Elle dit aussi : « Nous ne sommes pas d’hier, mais de là d’où nous venons. » Elle dit enfin : « Si l’on combat, c’est-à-dire si l’on rêve. »
Si l’on combat, c’est-à-dire si l’on rêve… La transition me vient donc de la forêt Lacandone, de ce Chiapas où Marc Tomsin, éditeur-voyageur et anar-chiste aux semelles de vent, a beaucoup bourlingué. On ne dira jamais assez en quoi ce Chiapas en rébellion alimenta, au sortir de la sinistre décennie des années 1980, le retour de cette part du rêve émancipateur que le capitalisme total, totalisant et totalitaire avait cru voir anéanti, en l’an 1989, avec la chute de l’autre capitalisme, celui d’État, qui lui croyait en avoir fini depuis longtemps et pour longtemps avec l’idée même de révolution.
Cultiver l’imaginaire d’une vie pensée et vécue en dehors ou le plus en marge du capitalisme a toujours été central, nous dit Alain Pessin, dans la rêverie anarchiste. Non pour s’y évader au pays d’Utopie, mais pour se forger une identité d’en-dehors du monde réellement existant et humainement révoltant qui nous accable. Cette idée de sécession offensive réapparait au-jourd’hui dans les luttes. Elle se décline sous différentes partitions : la brèche ou la faille à agrandir, la lutte contre les mégaprojets de destruction des communs, l’occupation de territoires d’expérimentation collective, la restauration du vivant partout où cela est possible. Comme réapparaît, sur un autre plan, le désir de redonner sens, de manière consciente ou inconsciente, à cette idée majeure de la rêverie anarchiste des premiers temps du mouvement ouvrier auto-organisé, à savoir son aspiration à ne dépendre que de ses propres capacités collectives d’action directe et d’autonomie de décision.
« L’anarchisme – écrivait Alain Pessin – pénètre dans la durée sociale par percées passagères, et s’en efface pour resurgir spontanément après de longues années d’absence. C’est là son bonheur historique que cette éternelle jeunesse, qui tient au fait d’être oeuvre d’imagination d’abord, et construction politique seulement ensuite, et parfois. »
Cette rêverie ne ferme jamais aucune fenêtre de tir. Et c’est bien comme ça.